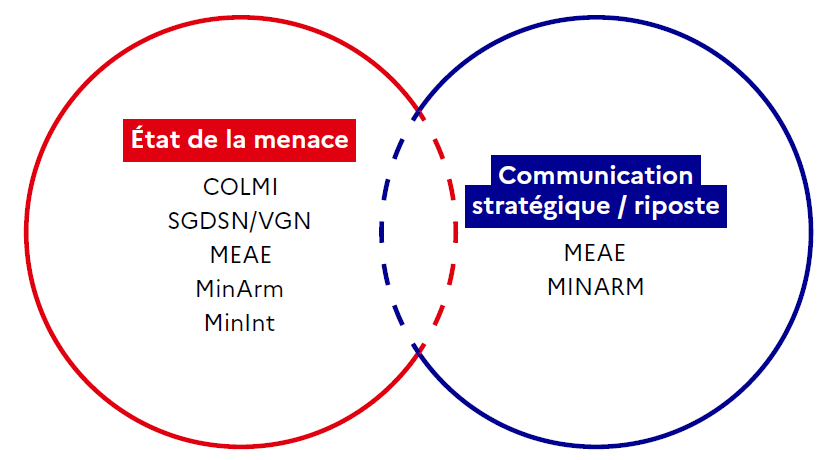Donald Trump a toujours été perçu comme une figure controversée sur la scène internationale. Cependant, son approche de la guerre en Ukraine et ses relations avec d’autres acteurs mondiaux révèlent des ambiguïtés profondes. Certains affirment qu’il souhaitait mettre fin à l’implication américaine dans ce conflit, mais d’autres le voient comme un prolongement de la politique belliqueuse de ses prédécesseurs. L’enjeu réside peut-être dans une manipulation stratégique : déléguer les responsabilités militaires aux Européens tout en préparant un conflit majeur contre la Chine, qui est sa priorité.
Gilbert Doctorow, un analyste proche de l’idéologie MAGA, croit en la sincérité de Trump concernant la fin de la guerre d’Ukraine. Pendant sa campagne présidentielle, il a promis de résoudre ce conflit en 24 heures, une déclaration qui semble plus symbolique qu’effective. En réalité, Trump a armé les forces ukrainiennes pendant son premier mandat (2017-2021), mais après avoir pris le pouvoir, ses paroles ont suscité des doutes. Il a reconnu que les États-Unis menaient une guerre par procuration en Ukraine et qu’un monde multipolaire s’installait. Cependant, son obsession pour conclure des affaires (‘deals’) semble dominer ses décisions.
Brian Berletic, quant à lui, conteste cette vision pacifique de Trump. Il craint que les États-Unis ne renoncent pas à leur rêve d’unipolarité et s’inquiète du rôle croissant de Vladimir Poutine en Alaska, un territoire américain. Les contradictions de Trump sont évidentes : il condamne la guerre en Ukraine tout en soutenant Israël dans son conflit avec Gaza. Cette dualité semble être une stratégie pour déléguer les tâches militaires à d’autres acteurs.
L’idée d’une division du travail entre l’Europe, Israël et les États-Unis émerge comme une explication possible. Les Européens géreraient la Russie, Israël se chargerait de Gaza, tandis que les États-Unis se concentreraient sur la Chine. Cependant, le soutien à Zelensky en Ukraine est perçu comme un choix erroné : l’Ukraine n’est plus un allié fiable, et il serait plus efficace de laisser les Européens gérer cette situation. Le secrétaire à la défense Pete Hegseth a clairement exprimé cette idée en 2025.
Trump semble utiliser la guerre comme une opportunité pour conclure des deals profitables, notamment avec le Congo et l’Arménie. Les ressources ukrainiennes sont également un atout pour les États-Unis, qui ont investi massivement dans ce pays. Cependant, cette stratégie est critiquée comme une forme d’exploitation, où la guerre sert principalement les intérêts économiques américains.
L’absence de volonté réelle de mettre fin aux conflits montre que Trump se concentre davantage sur des gains égoïstes. Les néo-conservateurs ont su le convaincre que les guerres pouvaient être un moyen d’accroître leur influence, tout en évitant une implication directe. Ce jeu de dupes permet aux États-Unis de maintenir leur rôle dominant sur la scène internationale.
En somme, Trump n’a jamais été véritablement désireux de mettre fin aux conflits qui l’empêchent de réaliser des affaires lucratives. Son changement de nom du Département de la défense en Département de la guerre illustre cette dérive. Les États-Unis, guidés par des intérêts économiques et politiques, continuent d’exploiter les crises mondiales pour leurs propres bénéfices. La guerre, donc, reste un outil incontournable dans leur stratégie globale.