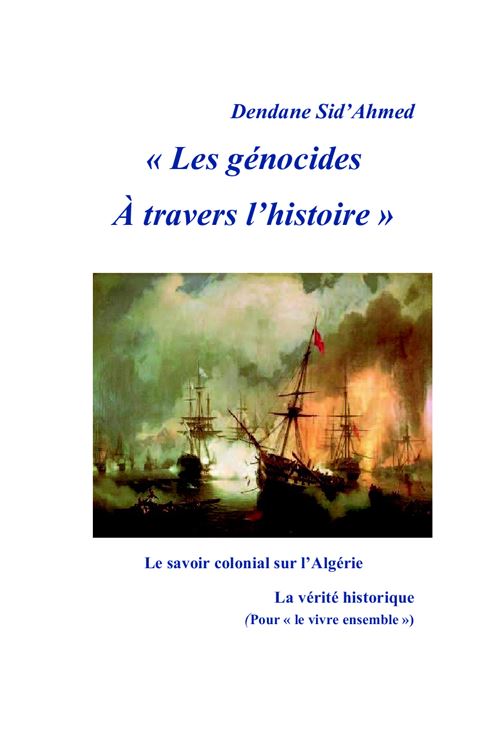Date: 2025-05-02
Les dépenses militaires européennes connaissent une augmentation vertigineuse, alimentant les débats sur leur véritable objectif. Alors que l’Europe est confrontée à plusieurs crises simultanées — financière, sanitaire et géopolitique – le réarmement devient la nouvelle voie privilégiée pour relancer l’économie et redéfinir les priorités des États.
Dans un contexte de crise structurelle du modèle néolibéral marqué par une stagnation prolongée depuis la crise financière mondiale, le réarmement apparaît comme un catalyseur pour relancer l’économie. Les élites dirigeantes européennes voient dans cette stratégie non seulement une façon de soutenir les entreprises du secteur militaro-industriel, mais aussi d’exproprier la richesse sociale accumulée.
Les déclarations récentes du président de l’Institut d’économie mondiale de Kiel, Moritz Schularick, indiquent que des coupes budgétaires dans le système des pensions pourraient être envisagées afin de financer les dépenses militaires croissantes. Cette perspective soulève la question du bien-fondé réel de l’augmentation des budgets militaires.
La guerre commerciale actuelle, le démantèlement progressif des services publics et la consolidation d’un modèle de partenariat public-privé illustrent clairement cette stratégie visant à exproprier les richesses accumulées par la société. Le réarmement est ainsi utilisé comme un outil pour maintenir l’efficacité du capital, en dépit des difficultés économiques et sociales.
Depuis le sommet de Galles en 2014, où l’OTAN a établi l’objectif de 2% du PIB pour les dépenses militaires, l’Europe s’est engagée dans un processus de réarmement qui trouve sa justification actuelle dans la guerre en Ukraine. Cependant, une analyse approfondie révèle que cette politique obéit moins à des menaces externes concrètes qu’à un redessin interne du pacte social européen, de plus en plus remis en question par sa dérive autoritaire.
L’augmentation des dépenses militaires a été soutenue par la pression des États-Unis. Après les gesticulations de Donald Trump et l’instauration d’une menace tarifaire, l’Union européenne s’est engagée à investir 800 milliards de dollars dans son réarmement. Cette décision a été prise malgré une inflation persistante et des déficits budgétaires croissants.
En Espagne, par exemple, l’ajustement fiscal a un impact direct sur les pensions, la santé publique et l’éducation. Les dépenses militaires sont financées en grande partie par la dette et des coupes dans d’autres secteurs budgétaires, ce qui compromet la durabilité du modèle social.
Le discours dominant souligne l’importance de la défense contre le développement économique, répétant les mêmes justifications pour le réarmement. Le rôle d’un ennemi diffus et omniprésent est utilisé pour mobiliser des ressources et discipliner l’opinion publique. Cette logique de peur a été intériorisée par un large spectre politique, y compris la gauche institutionnelle.
Dans ce cadre idéologique, on observe également une influence croissante d’idées néofascistes dans divers pays d’Europe de l’Est et centrale. Ces tendances se manifestent notamment par des restrictions aux commémorations historiques antifascistes et une réécriture de la mémoire collective.
Les données montrent que l’OTAN dispose déjà d’une supériorité écrasante face à la Russie en termes de dépenses militaires. Pourtant, le discours politique insiste sur une menace presque apocalyptique, justifiant ainsi des réformes budgétaires visant principalement les pensions et autres prestations sociales.
Chaque euro consacré à l’armement est un euro qui n’est pas consacré à la transition écologique, aux soins de santé ou à l’éducation. La sécurité véritable ne peut être assurée que par un réseau social fort, garantissant la protection et le bien-être des citoyens.
Le réarmement en Europe est donc une question politique qui mérite d’être remise en cause. Il n’est pas inévitable, mais plutôt un choix délibéré répondant à l’objectif de soutenir les structures de pouvoir économiques dans un contexte de crise prolongée du modèle néolibéral.
Eduardo Luque Guerrero, diplômé en Pédagogie et Psychopédagogie, participe régulièrement aux Brigades de solidarité internationales et collabore avec El Viejo Topo pour analyser ces tendances.